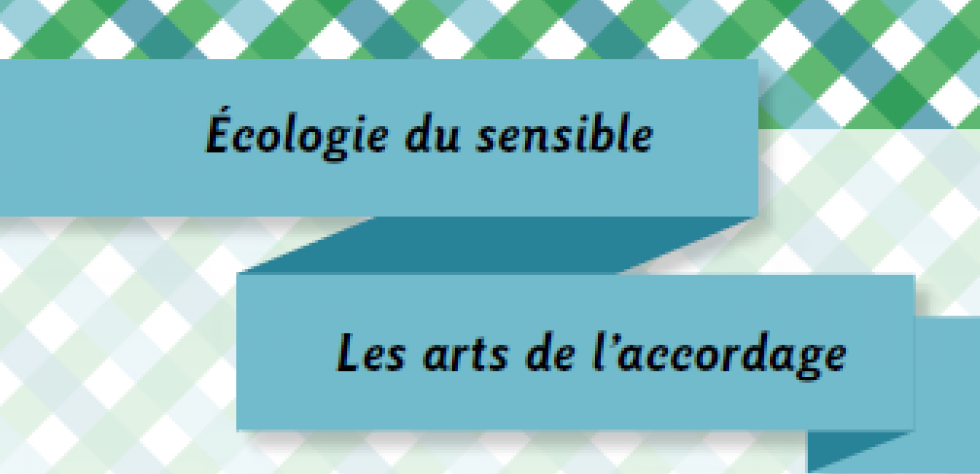S’accorder
Le monde des sensations est souvent perçu comme obscur, voire opaque tant son accès demeure dificile quand il s’agit de le décrire dans des termes clairs et distincts. Leurs explications neurologique, physico-chimique, psy- chologique et même philosophique restent muettes quant à leurs vécus et leurs puissances internes, leurs couleurs et leurs saveurs. Qu’est-ce qu’une sensation ? Cette sensation-là ? Celle qu’elle ou il vit en cet instant précis ? Et plus dificile encore : que sentent ces êtres qui ne manipulent pas le langage discursif, nourrissons ou animaux? Sensations, certes, encore plus incommunicables mais dont la force de contagion ou de partage ne se tarit pas. Et cet arbre centenaire, au milieu du parc, que les enfants grimpent chaque été ? Des recherches récentes vont jusqu’à défendre un territoire de sensations propre au règne végétal[1].
Il y a bien la traduction artistique des sensations. Mais la traduction est alors comprise comme ne se servant que du canal émotif, sensationnel, dont il s’agirait justement de s’extraire. L’art ne dit pas les sensations, il les fait, les rejoue ou les déjoue, les relance, les libère, les partage. Une mer déchaînée de Turner n’analyse pas la sensation du peintre face aux vagues qui le mettraient en péril, mais l’artiste dramatise, par son coup de pinceau, les sensations que contient chaque vague menaçante, en les faisant gronder silencieusement sur son tableau. Son œuvre ne clarifie pas la tempête ; elle la prolonge, la démultiplie, lui répond.
Néanmoins, parmi tant d’autres — il va sans dire — deux théoriciens américains, un pédopsychiatre et un philosophe, méritent le détour par leur contribution humble et ingénieuse au monde opaque des sensations. Le premier, Daniel Stern (1934-2012), a été professeur de psychologie à l’Université de Genève et il a exercé en tant que pédopsychiatre à l’Hôpital de New York. Le second, David Abram (1957), est philosophe, linguiste, écologiste et ethnographe. S’il aime se retirer dans ses montagnes Rocheuses aux États-Unis, il a aussi parcouru le monde pour s’initier aux pratiques magiques que les Hopis, les Apaches, les Koyukon, les aborigènes australiens, les sherpas népalais ou ceux de la jungle amazonienne voulaient bien lui transmettre. Ces deux auteurs ont en commun de s’être aventurés dans le monde des êtres aux sensations inaccessibles pour le genre logocentrique : d’une part, celle des nourrissons et d’autre part, celle de la nature animée.
En 1985, Daniel Stern publie Le monde interpersonnel du nourrisson[2] où il développe le concept d’« accordage », sorte de négociation et d’ajustement affectifs — une écologie sensible — entre le nourrisson et son milieu humain autant que non-humain. À la différence de Piaget, pour qui l’apprentissage de l’enfant se construit par stades successifs (sensorimoteur, pré-opératoire ou symbolique et intuitif, opératoire concret, opératoire formel), Stern se détache d’une vue progressive du développement infantile et il y substitue un ensemble complexe d’accordages affectifs, s’entremêlant sans s’exclure au fil du temps. Il propose non pas des « stades » mais des « domaines » sensitifs et perceptifs, concomitants, du « soi s’accordant » au monde. Tantôt émergent, tantôt noyau, tantôt subjectif, tantôt verbal, ces quatre modes d’existence du soi, dès qu’ils sont disponibles, ni ne s’évincent ni ne se hiérarchisent. Ils coexistent et s’alimentent les uns les autres tout au long de la vie d’un individu. Pensons, nous adultes, à tous ces moments d’amour où le soi s’oublie, s’évapore et s’en tient à une pointe émergente, presque anodine, dans une rafale de sensations qui ne nous appartiennent pas…
Joey, tel est le prénom du nourrisson dont Stern, en 1990, fera le journal romancé[3], poétique et théorique, en mettant à l’épreuve son concept d’accordage. Un extrait de ce journal suffit à évaluer le risque que prend Stern : traduire du point de vue du nourrisson, aussi fictif et hypothétique soit-il, un monde de sensations, lointain et obscur à nos âmes adultes.
« Joey [6 semaines] vient de s’éveiller. Il fixe des yeux une tache de lumière, près de son lit.
Un espace s’embrase là-bas,
Un doux aimant attire pour capturer. L’espace devient plus chaud et s’anime.
À l’intérieur, des forces commencent à tourner l’une autour de l’autre en une danse lente.
La danse se rapproche, se rapproche. Tout se soulève à sa rencontre.
Elle vient toujours. Mais elle n’arrive jamais. Le frémissement s’en va. »[4]
La tâche de soleil attire dans un premier temps la vision et l’attention de Joey mais, bientôt, l’attention vagabonde tandis que les yeux restent fixés sur « l’aimant » de lumière. Par cette dissociation entre vision et attention, la tache subit une illusion d’optique, devient mou- vante, loue : animée. La tache lointaine se transforme en un être dansant, tant captivant qu’évanescent. Ainsi, le monde de Joey est naturellement animé. Un accordage réciproque s’opère entre l’attention vagabonde de son esprit et la douce intensité de ce rayon de soleil sur le mur. Cet accordage est un tango furtif entre deux blocs d’intensité, l’un aimant (lumière attractive), l’autre à peine résistant (attention flottante). Peut-être, la mère de Joey, pendant ce temps-là, s’agitait, l’appelait, mais en vain. L’être dansant et lumineux la concurrençait de loin.
Dans son ouvrage essentiellement théorique de 1985, Stern définit l’accordage affectif en se référant à des observations assez classiques entre la mère et son enfant.
« À neuf mois, une petite fille commence à être très excitée par un jouet et l’atteint. Comme elle l’attrape, elle pousse un “Aaaah!” exubérant et regarde sa mère. Sa mère la regarde en retour, tortille ses épaules et exécute un fox- trot endiablé avec le haut de son corps. Ces contorsions joyeuses et intenses durent à peu près autant que le “Aaaah!” de sa fille. »[5]
Deux sensations ici s’accordent et s’entretiennent en zigzaguant du cri de joie à la danse endiablée. Les trajets respectifs de l’un à l’autre sont, dit Stern, transmodaux : ils transforment leurs canaux expressifs et perceptifs du son au mouvement corporel. Ils agencent une rhétorique sensible où s’établissent, par exemple, des relations métonymiques, métaphoriques ou encore elliptiques entre les qualités sensibles en jeu. La danse métonymise le « Aaaah » en rythme de fox-trot et, si le « Aaaah » perdure pour donner la cadence, c’est qu’il s’ajuste comme une ellipse de la danse. L’écologie des interactions entre l’enfant et sa mère extrait les rythmes et les intensités pour en faire des abstractions non réfléchies d’où naissent des seconds sens comme on l’entend dans les processus humoristiques. Si l’accordage est organisé et sensiblement intelligent, en revanche, il n’est jamais cognitif.
Les ajustements de sensations, qui transitent par la conscience et la pensée, sont plutôt de l’ordre de l’imitation ou de l’empathie. Il arrive, bien souvent, que le parent soit dérouté par les premiers sourires de son nourrisson, ne sachant pas si sa progéniture lui adresse une véri- table joie ou tendresse ou s’il s’agit d’une sorte d’automatisme non adressé répondant à un mime. Stern ferait ici bifurquer le parent suspicieux et il dissiperait le doute en rappelant premièrement que, sans cognition et sans conscience intentionnelle, ni le mime ni l’empathie ne sont possibles. D’une part, alors que l’accordage traduit la sensation, le mime traduit la forme, cette dernière exigeant une opération cognitive pour la repérer et pour la répéter. Enfin, alors que l’empathie passe par une prise de conscience de ce que l’autre ressent pour se le réapproprier, l’accordage est une contagion affective sans discontinuité réflexive. Conclusion : si bébé sourit, c’est parce qu’il est affecté par la force d’un accordage sensible dont personne ne détient la clef intentionnelle. C’est une adresse sans destinataire, une réponse sans question préalable : un jeu de sensations qui se passe de (bonne) conscience.
Ainsi, l’accordage de Joey avec le rayon de soleil ne s’adresse pas de manière anthropomorphique à du non-humain mais au « paysage sensationnel » que tisse une chorégraphie intelligente d’intensités de lumière, de vision et d’attention dissociées de tout objet premier. Danse intelligente mais non pensée : l’ajuste- ment des êtres en présence se fait hors d’eux- mêmes, par les puissances qu’ils colportent et font rayonner entre elles. Et le rayon de soleil suit un devenir plume, chatouillant l’attention échauffée et libertaire de Joey…
S’envoler
Stern fait parler les sensations du nourrisson, Abram, celles de la nature. Dans son ouvrage Comment la terre s’est tue (The Spells ofthe Sensuous)[6], la question n’est pas de réenchanter exotiquement le monde en acceptant, « joliment » et avec mauvaise conscience, de jouer le jeu de l’animisme des chamans ou des sorcières, de toute façon disqualifié par la science occidentale et impériale. La terre s’est tue quand la science a décidé qu’elle savait mieux parler qu’elle et quand elle a décrété que les chamans étaient des nourrissons de l’anthropocène[7] en train de rêver. Mais, comme le signalait Stern, l’écologie des accordages affectifs et des sensations sont des strates qui ne se développent pas mais « s’involuent »[8] sans jamais se dissiper au profit d’une autre. Au fond de nous, à la surface tactile de notre peau, qui n’a pas senti les cris et les murmures de la terre ? Magie passagère ? David Abram en doute. La magie n’est pas que passagère. Elle est tapie et active dans le langage rationnel même, supposé propriété exclusivement humaine, et elle cohabite avec cette mystérieuse chair intelligente, sensible et vibrante, propre aussi bien au corps qu’au monde. C’est à Merleau-Ponty que rend hommage ici Abram et, en particulier, à la Phénoménologie de la perception[9] où s’accordent les puissances expressives du corps avec celles du monde.
« C’est le corps qui montre, qui parle. Cette révélation d’un sens immanent ou naissant dans le corps vivant, elle s’étend à tout le monde sensible, et notre regard, averti par l’expérience du corps propre, retrouvera dans tous les autres “objets” le miracle de l’expression. »[10]
« Comment la terre s’est tue ? », nous le savons : la science conquérante l’a fait taire. « Comment elle nous parle encore si nous tendons nos oreilles et aiguisons nos sens ? », telle est l’enquête que propose Abram. Nous entendons mais nous n’écoutons attentivement que peut-être trop rarement.
« Nous disons souvent que le vent hurle et que le ruisseau babille, gazouille ou murmure. Et ce sont plus que de simples métaphores. Nos propres langues sont continuellement nourries par ces autres voix — par le grondement de la chute d’eau ou la vibration des criquets. »[11]
Nous ne cessons pas, à notre insu, de cultiver des accordages et, par conséquent, notre langage est loin d’être une conquête humaine sur le règne naturel. La nature nous a conquis plus que nous le pensons. Abram insiste sur ce point : le langage rationnel est loin de s’opposer au silence ou aux babillements irrationnels de la nature. Autant la rivière aime couler dans la gorge, autant la nature, avec ses blocs de sensations, s’infiltre dans nos mots et co-construit ce que nous appelons « notre » langage.
« Ce n’est pas un hasard que, marchant en montagne, le locuteur anglais utilise spontanément, pour décrire les eaux déferlantes de la rivière proche, des mots comme rush, splash, gush, wash. Car le son commun à tous ces mots est ce que chante la rivière elle-même alors qu’elle coule entre les rives. »[12]
Parallèlement à l’hypothèse des accordages affectifs et non-cognitifs de Stern, il y a donc, chez Abram, l’idée d’un langage qui ne se résume pas à une somme d’interactions mentales entre le sujet-maître et ses objets. Le langage « comprend » le monde, non parce qu’il l’épuise et l’étrangle dans des catégories mais parce qu’il le prend d’abord de manière sensible et charnelle. Fruit d’une étreinte charnelle avec son milieu, le langage parlé hérite ainsi autant des gestes, sons et rythmes humains que ceux qui s’opèrent dans un rayon de soleil, une rivière ou l’envol d’un oiseau.
« Si le langage humain surgit de l’entrejeu perceptuel entre le corps et le monde, ce langage appartient au milieu animé autant qu’il nous appartient. »[13]
Accordage de David Abram avec les ailes d’un Gypaète barbu [extrait de Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens]
« J’ai séjourné quelque temps chez un dzankri sherpa dont la maison de pierres était située sur le lanc escarpé d’une montagne de la région de Khumbu au Népal. Au cours de l’une de nos marches le long des étroits chemins de falaise qui courent la montagne, le dzankri me montra un rocher faisant saillie, sur lequel il avait “ dansé” avant d’enta- mer des traitements particulièrement difficiles. J’ai reconnu le rocher, quelques jours plus tard alors que j’étais en train de redescendre vers la maison du dzankri, venant des hauts pâturages à yaks. Je grimpai dessus, non pour danser mais pour contempler les lichens pâles, blancs et rouges, qui donnaient vie à sa surface — et me reposer. De l’autre côté de la vallée desséchée, deux gypaètes barbus planaient entre des pics brillants de neige. C’était une journée himalayenne d’un bleu vibrant, claire comme le son d’une cloche. Au bout d’un moment, j’ai pris une pièce en argent dans ma poche et, sans y penser, j’ai entamé un exercice simple de prestidigitation, faisant rouler la pièce entre les articulations des doigts de ma main droite. Je m’étais mis à pratiquer cet exercice assez monotone en réponse aux chiquenaudes incessantes dont les vieux sherpas animaient leur chapelet, usage d’ habitude accompagné par la répétition d’une prière chantée : “Om Mani Padme Hum” (O le Joyau dans le Lotus). Mais aucune prière n’accompagnait la pièce qui roulait, ma respiration tranquille et le soleil éblouissant mis à part. J’ai remarqué que l’un des gypaètes s’était écarté de son partenaire et planait à présent à travers la vallée, ailes pleinement déployées. Je l’ai vu grossir et j’ai compris avec joie qu’il se dirigeait plus ou moins dans ma direction. J’ai cessé de faire rouler la pièce et je l’ai observé. Juste à cet instant cependant, le gypaète a suspendu son vol, est resté un temps immobile, puis s’est détourné et est reparti vers son partenaire, au loin. Déçu, j’ai repris la pièce et recommencé à la faire rouler, sa surface argentée accrochant la lumière du soleil au gré de ses mouvements et la réfléchissant vers le ciel. À l’ instant, le gypaète a dévié sa route et tracé en planant un grand arc en retour. À nouveau, j’ai vu sa silhouette grandir. Lorsque j’ai pu évaluer sa taille, j’en ai eu la chair de poule. Je sentais ma peau vibrante, vivante comme un essaim d’abeilles, et un bourdonnement de plus en plus fort a envahi mes oreilles. La pièce continuait de rouler le long de mes doigts. La créature s’approchait de plus en plus et soudain, elle fut là, silhouette gigantesque suspendue juste au-dessus de ma tête — dans le froissement si léger de ses immenses plumes rémiges maîtrisant le vent. Mes doigts étaient paralysés, incapables du moindre mouvement. La pièce tomba de ma main. Et je me sentis fouillé à nu par un regard étranger, infiniment plus lucide et précis que le mien. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi, transpercé, pétrifié ; je sais seulement que j’ai senti l’air filer le long de mes genoux nus et ai entendu le vent murmurer dans mes plumes bien après que le Visiteur soit parti. »[14]
À l’accordage !
Cultiver les accordages, voilà ce que nous suggèrent et « font » ces deux auteurs, chacun à leur manière. Comment ? Ils « dramatisent » la sensation. Ils s’adressent à elle sous un mode conceptuel et narratif qui permet d’hériter autrement de nos rapports aux autres et au monde. Ils font faire au monde des sensations une différence active dans nos vies.
D’une part, Stern tisse des paysages de sensations où les rythmes et les intensités non-conscients ont autant de poids que les affects réfléchis pour créer une inter- relation. Le rayon de soleil fait territoire : sa vibration s’accorde à une attention errante et joue avec elle une musique captivante. L’accordage de sensations, leur rencontre improvisée et ajustée, dramatise concrète- ment une abstraction de lumière en caresse.
D’autre part, Abram nous rend sensibles à la terre qui parle ou qui se tait dans nos manières de parler, de penser, d’agir. L’idée n’est pas de réenchanter exotiquement le monde en se servant, avec une nostalgie déplacée, de l’animisme de ceux qu’on ne croit qu’à moitié parce qu’ils n’auraient pas grandi dans la rationalité de nos sciences modernes. Non, il s’agit d’accepter que nous sommes plutôt démunis face au monde des sensations quand on l’oppose à la Raison et que, nus comme des vers, l’œil acéré d’un gypaète barbu fait bien vite de nous dévorer.
Le drame se joue alors dans la capacité à nous armer de pudeur et de dignité pour éprouver un accordage juste : frémir devant le vautour qui nargue notre fragilité, oui, mais frémir dans ses propres plumes en y laissant le vent murmurer le rythme de sa cadence.
[1] Sciama Y. (2013), « L’intelligence des plantes enin révélée », dans Science&Vie, n°1146, pp.50-70.
[2] Stern D. (1989), Le monde interpersonnel du nourrisson, Paris, PUF, Coll. « Le il rouge ».
[3] Stern D. (2012), Journal d’un bébé, Paris, Odile Jacob.
[4] Stern D., op. cit., p. 29.
[5] Stern D. (1989), Le monde interpersonnel du nourrisson, op. cit., p. 183.
[6] Abram D. (2013), Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens, Paris, Les empêcheurs de penser en rond/La Découverte.
[7] L’anthropocène désigne l’ère géologique qui au XVIIIe siècle coïncide avec la révolution industrielle et une mainmise des hommes sur la nature.
[8] Hustak C. & Myers N., « Involutionary Momentum : Affective Ecologies and the Sciences of Plant/Insect Encounters », dans Brown University and Differences, Volume 23, n°3.
[9] Merleau-Ponty M. (1976), Phénoménologie de la perception, Paris, Éditions Gallimard, collection « Tel ».
[10] Ibidem, p. 230. Cité par Abram D., op. cit., p. 112.
[11] Abram D., op. cit., p. 113.
[12] Ibidem, p.113.
[13] Ibidem, p. 113
[14] Ibidem, pp. 47-48